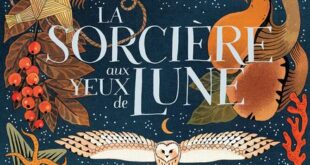C’était il y a 100 ans… 1925.
La Tour Eiffel abrite la première station de radiodiffusion en France. Freda Josephine McDonald – que Paris s’apprête à découvrir sous le nom de Joséphine Baker – foule pour la première fois le sol européen. En Italie, Mussolini abolit la démocratie parlementaire et fait entrer son pays dans l’ère fasciste. Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, F. Scott Fitzgerald achève les dernières lignes de ce qui deviendra un des romans les plus lus du XXe siècle.
« Ainsi allons-nous, barques luttant contre le courant, ramenées sans cesse vers le passé. »
On dit souvent que la dernière phrase de Gatsby le Magnifique reflète l’humeur fébrile de cette époque. La guerre est finie, mais elle habite encore les regards. Dans les grandes villes occidentales, on parle de rêves, d’ivresse et de vitesse — et l’on tâche d’enterrer le doute et le pessimisme sous les feux de la rampe.
À Paris, peut-être encore plus qu’à New York, on danse, on invente, on rit trop fort, comme pour conjurer les illusions perdues et invoquer des nouvelles, encore plus grandes, plus folles, plus brillantes. La ville bouillonne d’art et d’audace. Jazz, poésie et liberté dessinent les contours d’un monde ivre de renaître. C’est dans ce monde et dans cette ville que se promène un pianiste solitaire, lunettes rondes, parapluie noir, sempiternel costume de velours noir. Compositeur de l’ironie douce et des silences habités, Érik Satie a 59 ans en 1925.

Quelques années plus tôt, on le croisait souvent dans les brumes pâles de Montmartre, tard le soir, silhouette énigmatique drapée d’élégance désuète. On le voyait au Chat Noir, accompagnant des spectacles au piano, ou à L’Auberge du Clou, dînant avec Debussy et d’autres artistes décidés à se déjouer de ce qu’ils appelaient la « médiocrité fameuse » de l’art institutionnel.
« Je suis venu au monde très jeune dans un monde très vieux » écrit-il a son amie Linette Chalupt en 1914. En effet, Satie traverse le changement de siècle dans une certaine marginalité, il refuse les dogmes, les grandes formes, les effets. Il compose des pièces brèves, souvent ironiques ou humoristiques, à rebours du romantisme dominant. Gymnopédies, Gnossiennes, Morceau en forme de poire, Préludes flasques (pour un chien), etc. Son œuvre, d’apparence simple, préfigure par endroits le minimalisme et rejette toute démonstration de virtuosité.
Les années passent, et vieux monde que connait le jeune compositeur est pourtant en train de changer.
Satie décède le mercredi 1er juillet 1925, à Paris. Quand ses amis pénétrèrent dans son sanctuaire d’Arcueil, ce studio que Satie avait toujours gardé scellé, ils y découvrirent deux pianos désaccordés, attachés l’un à l’autre et bourrés de lettres et des partitions. Dans un placard, une armée silencieuse de parapluies et de faux cols.
Ça arrive parfois, surtout en ce début de siècle, que le hasard enfile un chapeau melon de poète symboliste.
Quatorze mercredis avant le décès de Satie, c’est un autre pianiste et compositeur qui voit le jour.
Pierre Boulez nait le 25 mars, dans la petite commune de Montbrison, dans la Loire.

L’enfant de Marcelle et de Léon, mère au foyer et ingénieur métallurgiste, hésite entre un avenir scientifique et musical. « L’appel » est trop fort, à ses 17 ans le jeune Pierre prend la décision de monter à Paris.
Boulez partage avec son prédécesseur « gymnopédiste » un dédain pour le classicisme et pour le status quo. Ils sont tous les deux des enfants de leur temps, mais les similitudes s’arrêtent à peu près là.
Deux regards : l’un vers l’intérieur, l’autre vers l’avant.
Le jeune Boulez ne se contente pas de moquer l’ordre établi, ou de faire chambre à part, il veut le prendre en assaut.
Après des études au Conservatoire de Paris, où il étudie avec Olivier Messiaen, Boulez s’impose dès les années 1950 comme un acteur majeur de la modernité musicale : architecte du son et théoricien de l’avant-garde, chef d’orchestre rigoureux, fondateur de l’IRCAM, théoricien.
Dans ses œuvres, le matériau sonore se transforme en temps réel. Le timbre devient structure, le silence devient tension. Rien n’est laissé au hasard. Sa musique ne raconte pas, elle explore le temps et l’espace. On n’y trouve pas de mélodie familière, mais un vertige d’architectures sonores en mutation constante – de Le Marteau sans maître à Répons, en passant par ses polyphonies, presque liquides.
Entre la dérision poétique de Satie et la rigueur révolutionnaire de Boulez, la musique française se souvient, un siècle plus tard. L’un écrit comme on rêve. L’autre compose comme on pense. Leur héritage, loin d’être figé, continue d’inspirer.
Aujourd’hui encore, de nombreux musiciens – qu’ils viennent du minimalisme, du jazz, de l’électroacoustique ou de la musique de film – puisent dans leur liberté créative et leur goût de l’expérimentation. En repoussant les limites de la forme, du son et du sens, Satie et Boulez ont ouvert des chemins que l’on explore toujours. Leur influence, discrète ou revendiquée, continue de faire bouger les lignes – et de faire couler de l’encre.
Venez emprunter l’intégrale des œuvres de ces deux compositeurs au 4e étage de la mlis !
 Médiathèques de Villeurbanne lire, écouter, voir
Médiathèques de Villeurbanne lire, écouter, voir